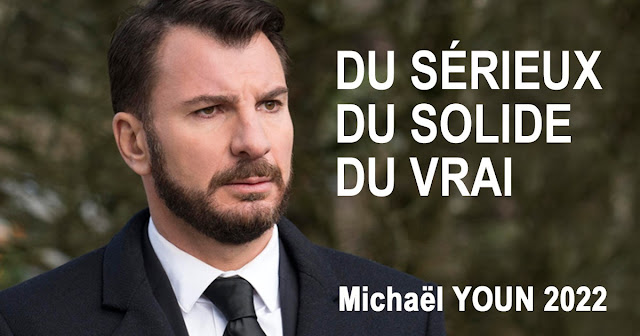Les vacances du politique comme feuilleton d’été à suivre se prêtent tout à fait à la mise en scène de la proximité. Elles participent de l’humanisation voire de la normalisation de la fonction, avec un politique présenté enfin « comme tous » : en t-shirt et polo, short et bermuda, claquettes et maillot de bain.
Le choix de la destination (qui déterminera in fine la façon dont l’opinion va percevoir le politique) est capitale en termes de retombées presse. Pour des questions d’image et de narration évidentes, le politique préfère donc rester sur le territoire national et privilégier la province : soit autant de symboles et d’éléments de story-telling à activer autour de l’ancrage local et du terroir et de cartes postales médiatiques décentes à envoyer au public.
Sport, nage, jet-ski, randonnée, café en terrasse, réunion de travail, sortie en tête-à-tête : les congés du politique sont avant tout le théâtre de l’image, recherchée par la presse, people en priorité.Test de popularité, le bain de foule comme événement attendu par la presse est à voir comme la sortie de scène de l’artiste : ce moment précis où après le show, l’homme de spectacle descend de l’estrade pour rejoindre dans la fosse son public à qui il autorise exceptionnellement, à aller approcher, rencontrer et toucher l’idole de toute une vie.
Le bain de foule témoigne du désir tactile du citoyen-spectateur à l’égard d’un politique rock-starisé, prompt dans cette espace-temps de divertissement aux petits mots, selfies, autographes, checks et autres attentions calculées. Pour la vedette-politique qui doit toujours occuper l’espace, le passage de l’écran du spectacle à la réalité du terrain auprès des enfants et des parents, des riverains et des touristes, vise à se rassurer. Pour le politique au pouvoir, le bain de foule est recherché en cas de baisse sondagière ou de désamour avec l’électorat. Parce qu’il est construit par et pour l’image, le bain de foule n’est jamais spontané. Il est souvent monté en amont avec une foule parfois filtrée et des « vraies gens » triées sur le volet.
« Où les ministres partent-ils cet été ? », « Avec qui passent-ils leurs vacances ? », « Vacances détente ou studieuse ? » : dans une période estivale propices aux meublages, la sphère médiatique, toujours en quête de contenus, réussit chaque année la prouesse de faire des vacances du politique, pourtant inintéressantes sur le fond comme sur la forme, un sujet de conversation, de débats et de bête contemplation, validé par le spectacle et sa logique de star-systémisation permanente.
François Belley
http://francoisbelley.fr